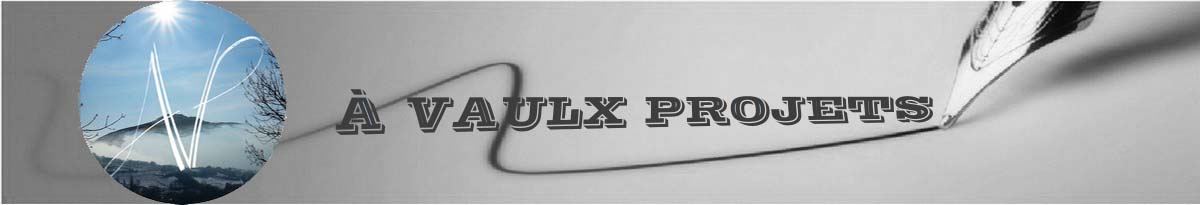Centenaire de la grande guerre

Lettres de poilus
Pour la mémoire et la paix
Lettres de soldats
F: la femme
H: l'homme

-H: Samedi 1er Août 1914
-F: Mobilisation générale pour 4 millions de français
-F: Lundi 3 août
-H: L'Allemagne déclare la guerre à la France
-F : AIME - 17 ans
-F : La traversée de Commercy se fit au pas cadencé arme sur l'épaule. Il importait de ne pas offrir le spectacle d'un troupeau incohérent et flasque. Montrer à la population les signes extérieurs d'une troupe organisée et disciplinée. Dieu ! Que c'est long ce bourg !
Ma baïonnette s'empêtre dans mes cuisses, mon col tiré en arrière m'étrangle...
-Ensemble : Une-deux, une-deux, une-deux !
-F : Vas-y c'est beau ! Regardez, bourgeois, notre pas cadencé permet à votre volaille de cuire en son four. Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette jolie et un peu mièvre. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute nous étions beaux...
-H : …et grands. Nous allions par là-bas, où l'on meurt,
-F : où l'on est défiguré,
-H : haché,
-F : déchiré... Et nous y allons au pas, au son des cuivres aigus.
-H : Nous portons dans nos cartouchières la mort. Nos fusils (ensemble) tuent.
-F : Nous sommes forts et doux peut-être...
-H : Nous sommes une bête formidable qui pourrait broyer cette enfant,
-F : sans la voir,
-H : sans entendre ses cris et sa plainte.
-F : Son admiration est une vague d'effroi et de piété.
-H : Nous sommes un énorme troupeau de formidables douleurs.
-F : Nous sommes un rempart des joies de l'amour, du bonheur.
-H : Sans accepter cette tâche, nous (ensemble) mourrons pour elle. Peut-être cette enfant ignorante, naïve, coquette, ne l'a-t-elle pas compris…
-F : Mais elle l'a senti.
-H : Son regard me réchauffe, son admiration m’a fait tendre le jarret, son sourire m'a donné du cœur.
-F : Elle était peut-être tout simplement jolie !
-H : À mes côtés, sous son regard, mes camarades eux aussi se sont redressés. Mille rêves ont peut-être caressé leur pensée. Un charme sensible paraît les avoir touchés,
-F : et parce qu'une fillette les voyait,
-H : ils eurent un regard plus serein et plus clair, une démarche plus ferme, un front plus guerrier.
-F : HENRI
-F : Chers parents,
À 19 ans, on doit être fantassin quand on est français et qu’on est jeune et fort, on doit être heureux et fier de pouvoir défendre sa patrie.
Quand on est français de date récente, et surtout quand on fait partie de cette race juive méprisée et opprimée, on doit faire son devoir mieux que personne.
Je n'aime pas la guerre, mais je n'en souffre nullement, ni au physique, ni au moral.
Je suis très heureux à l'idée qu'à la fin de la guerre, je pourrai être satisfait de moi.
-H : MAURICE
-H : Mon carnet, mon cher carnet, la plus intime chose que je possède ici ! Comme je suis heureux de t'ouvrir, de causer avec toi ! Quelle journée remplie, mon Dieu ! Je suis éreinté. Heureusement que notre gentil petit sergent m'a offert de partager un lit qu’il a trouvé chez une brave femme du pays.
Ce matin, nous avons été à l'exercice de la compagnie, en pleins champs. Cette vie toute nouvelle m’intéresse au plus haut degré, et puis ce beau temps continu, le soleil, l'air pur me font oublier absolument la cause de notre présence ici.
Va-t-on vraiment se battre ? Va-t-on vraiment se tuer ?

-F : Troisième semaine du mois d’août 1914
-H : En 5 jours : 140 000 morts.
27 000 morts pour la seule journée du 22 août.
-F : Fin 1914 : début de la guerre des tranchées.
-H : JULES
-F : Ma Louise,
Aujourd'hui, j'ai un peu plus de courage et je vais te raconter les trois journées terribles et d'enfer, où j'ai cru ne jamais te revoir. Comme je t'ai écrit, nous devions attaquer dans le bois d'Ailly si tristement célèbre. Enfin, nous sommes partis dimanche à midi de Vignot, on nous fait coucher dans le bois jusqu'à la nuit.
Puis nous partons, nous marchons jusqu'à 2 heures du matin. Nous arrivons enfin au point où nos lignes s’arrêtent, on nous donne le signal de la charge, et nous partons après nous avoir serré la main une dernière fois. Nous bondissons dans le feu des mitrailleuses des Boches embusqués dans leurs tranchées, la première ligne se rend au bout de quelques minutes, nous faisons neuf cent dix prisonniers et nous prenons deux mitrailleuses, là nous respirons cinq minutes et on repart plus loin…
Nous avons encore pris une autre tranchée et à la moitié d'un boyau de communication qui relie une autre tranchée allemande, justement, ma section se trouve dans le boyau, point dangereux entre tous. Les Allemands sont à trois ou quatre mètres de nous et tout homme qui est vu est un homme mort, nous sommes toujours ensemble, avec mon frère Camille, par moments il faut se découvrir pour tirer et ils n'arrêtent pas. Les cartouches manquent, nous prenons les fusils des Allemands, des prisonniers et des morts, et nous les tuons avec leurs munitions.
Vers 10 heures du matin, un homme de liaison du commandant vient disant qu'il faut tenir « à tout prix » et que l'on se prépare, les Allemands ont reçu du renfort.
Notre artillerie commence à les exterminer dans leurs tranchées, c'est horrible, les bras, les jambes, tout vole en l'air, et les cris affreux, alors ils se lancent sur nous avec des boîtes à mitraille, nous sommes au bout du boyau, les premiers tombent sur nous, je suis comme fou, les camarades tombent autour de moi, je ne vois plus rien, mais chose curieuse, je n'ai pas peur. Je comprends que si nous lâchons pied, nous sommes perdus, et pour tirer plus juste nous montons sur le talus de la tranchée. Là nous les tuons au fur et à mesure qu'ils avancent dans le boyau où ils ne peuvent passer qu'un à un. Mais leurs bombes tombent toujours, et c’est terrible de voir les camarades hachés, je suis tout couvert de sang, Camille à côté de moi tire sans arrêter ainsi que les autres qui restent debout…
H : Quand là, ma Louise, j'ai eu la plus grande peine, mon frère tombe à la renverse dans mes bras. Il vient de recevoir une balle dans la tête, et tu sais qu'elles ne pardonnent pas, je le panse tout de suite, hélas, il n'a pas souffert, il avait un trou comme un œuf et j'étais tout couvert de cervelle. Je le vois toujours devant moi, il n'a pas souffert et tout de suite il est mort en vomissant du sang de la bouche, du nez et des oreilles.
Si tu veux, fais part de ma lettre à Blanche, pour moi je n'en peux plus, et je n'ai pas la force de lui dire. Je lui ai écrit une carte où je lui dis qu'il est dangereusement blessé, ça la préparera un peu. Je crois que nous y retournons encore aujourd'hui, ou demain matin. C'est terrible, on ne peut qu'obéir.
Au revoir, ma Louise, ou plutôt adieu.

-H : DÉCLARATION DU MARÉCHAL FOCH
-F : Les lauriers de la victoire flottent à la pointe des baïonnettes ennemies !
C’est là qu’il faut aller les prendre, les conquérir par une lutte corps à corps si on les veut.
Se ruer, mais se ruer en nombre et en masse.
Se jeter dans les rangs de l’adversaire et trancher la discussion à l’arme froide.
-H : ETIENNE
-H : L’emballement, l’enthousiasme braillard et provocant me manquent absolument, et les idées de revanche, de vengeance, de grandeur nationale sont pour moi toujours fausses et barbares.
-F : JOSEPH
-F : Il faut bien envisager la réalité, sans se monter la tête : la guerre est comme la fièvre typhoïde ; il faut la fuir, mais si on l’attrape, il faut lutter.
-H : GEORGES
-H : Rencontre mon copain Balat. Il a aussi un couteau de charcutier, il y en a 50 par compagnie. C’est la guerre au couteau au 20ème siècle. À quoi serviront-ils ? À finir les blessés enfin.
-F : RENÉ
-F : Comment décrire ? Quels mots prendre ?
-H : Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, encore figé dans l'immobilité et le silence, Meaux avec ses bateaux-lavoirs coulés dans la Marne et son pont détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du nord... Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur.
Des cadavres allemands, ici, sur le bord de la route, là dans les ravins et les champs, des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés, autour desquels sous le soleil de septembre, bourdonnent des essaims de mouches ; des cadavres d'hommes qui ont gardé des pauses étranges, les genoux pliés en l'air ou le bras appuyé au talus de la tranchée ; des cadavres de chevaux, plus douloureux encore que des cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol ; des cadavres qu’on recouvre de chaux ou de paille, de terre ou de sable, et qu'on calcine ou qu’on enterre. Une odeur effroyable, une odeur de charnier, monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge.
-F : “ Champ de bataille ”
-H : Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage. Car les cadavres, ce n’est rien. En ce moment, j’ai déjà oublié leurs centaines de figures grimaçantes et leurs attitudes contorsionnées. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est la ruine des choses, c'est le saccage abominable des chaumières, c'est le pillage des maisons ...
-H : ANONYME
-H : Comment décrire ...
-F : La petite église à moitié éventrée, l’intérieur mis à sac.
Au milieu des plâtres et des pierres effondrés, une chaise est redressée.
On est venu prier dans ce chaos, le livre est encore ouvert sur le dossier.
Les arbres sont déchiquetés, les racines tordues gémissent vers le ciel.
Une tombe d’un soldat français, quelques pelletées de terre sur le mort de qui on aperçoit les deux bouts de souliers.
-F : ETIENNE
-H : Comment décrire ...
La nuit dans la tranchée. Tranchée de deuxième ligne, bien installée, petites niches individuelles avec de la paille. On peut y dormir. On déroule le couvre-pieds et bonsoir...
Tout à coup je m’éveille.
Partout des coups de fusils ; mes voisins s‘éveillent aussi et bouclent les sacs en vitesse et mettent bidon et musettes.
-F : « Les Boches attaquent »
-H : Les balles sifflent. Visages ahuris et inquiets. Silhouettes qui passent sur la route en courant et en se baissant. Je me fous par terre dans du fil de fer coupé. Le sac monté à la diable ballotte, les musettes battent les jambes. On se précipite dans les trous de tranchée n'importe comment.
-F : « Baïonnette au canon ! »
-H : crie le sergent qui se promène au milieu des balles sur la route, comme un paysan dans ses blés.
Ordre de ne pas tirer. La fusillade se calme. Elle traîne et cesse, on se redresse un peu, on respire, on regagne sa place. Il y a un blessé, au pied : c'est mon caporal.
Voix lointaines, bruits de disputes.
-F : « La section du lieutenant a tiré sur les nôtres ! »
-H : C'est terrible, la fréquence et la répétition de ces erreurs : patrouilles, sentinelles, malgré les recommandations, tirent à tort et à travers.
On respire. On l'a échappé encore ce coup-ci. On mange, on se recouche, on se rendort.
-F : MARCEL
-F : J’ai vu de beaux spectacles ! D’abord les tranchées de Boches défoncées par notre artillerie malgré le ciment et les centaines de sacs de terre empilés les uns au-dessus des autres ;
-H : Ça c’est intéressant !
-F : Mais ce qui l’est moins, ce sont les cadavres à moitié enterrés montrant, qui un pied, qui une tête ; d’autres, enterrés, sont découverts en creusant les boyaux.
-H : Que c’est intéressant la guerre !
-F : On peut être fier de la civilisation !

-H : PIERRE
-H : L’attaque du 9 a coûté…
-F : c’est le chiffre donné par les officiers,
-H : quatre vingt-cinq mille hommes et un milliard cinq cents millions de francs de munitions.
Et à ce prix, on a gagné quatre kilomètres pour retrouver devant soi d’autres tranchées et d’autres redoutes.
-F : GERVAIS
-H : Chers parents,
Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas ; moi-même, je ne l’aurai pas cru si je ne l’avais pas vu. La guerre semble autre chose, eh bien, elle est sabotée. Avant-hier - et cela a duré deux jours dans les tranchées - Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis ! Pas moi, j'en aurais eu regret.
Voilà comment cela est arrivé : le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent :
-F : « Kamarades, Kamarades, rendez-vous »
-H : Ils nous demandent de nous rendre “pour la frime”. Nous, de notre côté, on leur en dit autant ; personne n’accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête ; nous en faisons autant et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre, échange de cigares, cigarettes, et, à cent mètres, d'autres se tiraient dessus.
Je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales, dégoûtants ils sont, et je crois qu'ils en ont marre eux aussi.
Mais depuis, cela a changé. On ne communique plus. Je vous relate ce petit fait, mais n’en dites rien à personne. On doit même pas en parler à d’autres soldats.
Je vous embrasse bien fort tous les trois.
-H : HENRI
-F : Ma bien chère Lucie,
Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi :
Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de deux heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m’ont fait prisonnier avec deux autres camarades. J’ai profité d’un moment de bousculade pour m’échapper des mains des Allemands. J’ai suivi mes camarades, et ensuite, j’ai été accusé d’abandon de poste en présence de l’ennemi.
Nous sommes passés vingt-quatre hier soir au Conseil de Guerre. Six ont été condamnés à mort dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu’il y a dedans.
Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l’âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l’embarras dans lequel je vais te mettre.
Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Ma dernière pensée, à toi, jusqu’au bout.
Je meurs innocent.
-F : LÉONARD
-H : Je soussigné, Leymarie, Léonard, soldat de 2e classe, né à Seillac - Corrèze.
Le Conseil de Guerre me condamne à la peine de mort pour mutilation volontaire, et je déclare formelmen que je sui innocan.
Je suis bléssé ou par la mitraille ennemie ou par mon fusi, comme l’exige le major, mai accidentelmen, mai non volontairemen, et je jure que je suis innocan, et je répète que je suis innocan.
Je prouverai que j’ai fait mon devoir et que j’aie servi avec amour et fidélité, et que je n’ai jamais féblie à mon devoir.
Et je jure devandieux que je sui innocan.
-H : FRANÇOIS
-F : Je viens de recevoir le colis avec le tricot, les chaussettes, le pâté, les biscuits et la saucisse, tout cela est bien bon. Je te remercie beaucoup. Le tricot me convient aussi, il vaut mieux qu’il soit blanc pour mettre en dessous et puis il est très chaud, ainsi que les chaussettes. Pour le caleçon, ne te dérange pas, si j’y vais nous l’achèterons tous les deux, pour le moment je n’ai pas froid. Je ne sais pas si je resterai longtemps à l’hôpital mais j’ai l’espoir de rester quelque temps, car j’ai besoin d’engraisser un peu.
Ne te fais pas de mauvais sang. Embrasse bien les enfants pour moi.
-H : Le petit Jean, il semble que je ne le connaîtrais pas.
-H : MARCEL
-F : De loin la pensée vigilante des mères nous fait comme une enveloppe mystérieuse à notre âme s’emmitouflant à moindre froid et à moindre peur. Un peu de la tiédeur d’un sein y reste encore, et c’est d’une douceur triste et profonde, un peu trouble, comme les choses qui nous dépassent ou nous viennent de très loin. Oh ! Réseau léger, réseau exquis qui palpite devant les bottes comme une fine toile d’araignée au vent du matin frais, dans une crainte continuelle.
Et parfois dans le soir, de grands élans de tendresse nous secouent. On a marché, on lutte tous les jours, l’effort physique étouffait en nous la pensée. Telles des bêtes fauves on allait les sens tendus, le cœur bandé comme un ressort neuf. Brusquement, un frisson est venu, puis une lassitude infinie et le besoin immense d’être doux, d’aimer, de faire des caresses, d’avoir des paroles exquises, et de fondre tout entier dans un seul cri :
-H : Maman !
-H : ALBERT
-H : J’admire ce général, que je connais, et qui ne porte pas le deuil de ses fils, et qui n’en parle jamais - deux fils, toute sa tendresse et tout son orgueil, tombés le même jour, vingt ans et dix-neuf ans - qui ne porte pas leur deuil :
-F : “Pour ne pas attrister et amollir le courage de mes hommes”.
-H : FRANÇOIS
-F : Ma chère Marie,
Je t'ajoute encore ceci en cas d'accident, que je ne puisse pas retourner chez nous. Je te nomme toutes les choses ou objets qui sont restés chez moi, à la maison, pour que tu puisses y réclamer en cas que je ne puisse le faire moi -même. Ce sera toujours ton intérêt et celui des enfants. Voici les noms :
-H : 2 garde-robes et leur contenu
-F : 1 pressoir à tome
-H : Le gros et le petit horloge
-F : 3 bombonnes dont une avec huit litres d'eau-de-vie, une autre avec prune, 1litre environ
-H : 40 litres de navets dans un sac
-F : 6 bênons
-H : 1 gros bênon contenant un quart ...
-F : 3 gros tonneaux
-H : Une mâconnaise
-F : Un petit tonneau et le vinaigre s'il est bon
-H : Au fond de la remise à Jean-Marie, il y a une cave où il y a un tonneau de 400 litres environ avec du vin dedans tu regarderas à la maison d'en bas sous la remise, 2 échelles à foin, timon longes, presse et de la paille
-F : Au fenil : un certain nombre de planches sapin avec 1 ou 2 belles planches en noyer.
-H : Paille de toit à la chambre
-F : Le garde-manger et son contenu
-H : Beaucoup de fer à forger
-F : Des ferrures complètes d'une paire de jougs
-H : Beaucoup de bois de travail
-F : Les vieux bras du char à bancs
-H : Un grand cuvier à lessive avec son couvert et sa chaise
-F : Un saloir en chêne avec son couvert aussi et une chaise à s’asseoir neuve au grenier
-H : Je crois que c'est tout. Au cas où, tu pourrais demander à mon frère Casimir s'il ne reste rien.
Ton François qui t'aime pour la vie.